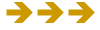Un vaisseau armé en flûte accroche le rocher du Pohen
Dans la nuit du 31 décembre 1790, la gabare - armée en flûte* - "Rhône"
de la marine royale française construite à Toulouse en 1781, heurte le rocher
du Pohen après une trajectoire risquée à l'Est de ce récif discret mais dangereux,
ceci d'autant que la tempête sévit. Le pilote a viré trop court après le Rocher
du Lion pour rejoindre Brest au plus vite. Le vaisseau de marchandise reste
perché sur la pointe rocheuse. Le Commandant, le lieutenant de vaisseau M. Sébire
de Beauchesne paraît dépassé. Le lieutenant de vaisseau François-Hyacinthe de
Bedée enlève son uniforme et se jette dans une mer déchaînée et glaciale dans
les ténèbres avec une corde. Il veut atteindre les récifs du Lion à cent mètres
au Sud-Ouest pour assurer, avec une poulie, un va-et-vient avec l'unique chaloupe
de sauvetage du bord. Il y parvient de sorte que les marins sont achemeninés
grâce au cordage qui les guide. Plusieurs heures passent avant que la chaloupe
emporte 70 marins dont un officier et le chirurgien de bord pour trouver des
secours à Brest. Les 98 militaires restant passent 27 heures difficiles agrippés
tant bien que mal au rocher du Lion battu par la mer, il semblerait que
dix d'entre-eux aient lâcher prise. Les secours arrivent enfin, c'est inespéré
pour l'époque. Sept autres marins auraient été perdus à bord de la flûte dont
certains éléments seront récupérés quelques mois plus tard : les mâts, les cordages,
des pièces de bois... C'est "la tradition des fortunes de mer" à chaque
fois que cela est possible. Le butin est revendu...
François-Hyacinthe de Bedée sera décoré de la Grand-Croix de Saint-Louis pour
cet acte héroïque. En 1787, l'officier s'était déjà distingué en ayant éteint
un feu qui se propageait auprès d'une charette de 7 barils de poudre à St Brieuc.
Il en fut félicité par le maire de manière officielle car tout un quartier de
la ville avait été menacé par l'explosion possible et l'incendie qui s'en serait
suivi. Ce brave marin semble avoir perdu sa santé après le naufrage et navigua
peu.
Parmi les marins, un mousse de 13 ans qui venait d'embarquer à Lorient pour
la première fois. René Constant Le Marant de Kerdaniel fait partie des rescapés
et finira sa carrière au grade d'amiral après avoir survécu à un autre naufrage,
été prisonnier des Anglais, participé à la bataille de Trafalgar et bien d'autres
engagements mais avec aussi un pied à l'amirauté à Paris en étant l'aide-de-camp
du ministre Decrès.
René Constant Le Marant de Kerdaniel aura la même distinction (dans d'autres
circonstances après 10 ans de grade d'officier) mais à une classe moindre, celle
de chevalier.
L'Ordre Royal et Militaire de St Louis distinguait les marins de haute volée
dès Louis XIV jusqu'en 1830 sans distinction de naissance. Néanmoins comme la
très grande majorité des officiers de marine était noble, la noblesse bénéficia
pratiquement à elle seule de cette décoration, ce qui était le cas des deux
marins de cette épopée qui appartenaient tous deux à la noblesse bretonne.
Quant au Lieutenant de vaisseau Sébire de Beauchêne, il poursuivit ses
commandements de flûtes dont le "Dromadaire" de Toulon en 1791
avec des missions de transport de troupes entre Lorient et Cayenne jusqu'à
devenir capitaine de vaisseau en 1793 sur la frégate "La Virginie"
dès 1794. Une frégate qui tomba entre les mains de la marine britannique
après un combat naval en 1796.
Dans l'épave de la flûte
qui existe encore ont été retrouvées des ancres de marine dont une en
pierre. Elles devaient être livrées pour des frégates de Brest. La pierre
était une fabrication économique que quelques patrons pêcheurs appréciaient
jusqu'à l'après guerre.
* Les flûtes ou fluttes sont des navires de commerce d'origine hollandaise
du 17ème siècle. Des vaisseaux "bas de gamme mais solides" en sapin
chevillé de bois, construits rapidement de manière économique sans pièce métallique
pratiquement qui en cas de guerre sont immédiatement transformés en vaisseaux
de ligne avec des canons (une vingtaine en moyenne). Moins d'équipage, plus
rapides que les navires en chêne, ce type d'embarcation va devenir une tendance
maritime européenne au 18ème siècle. Sur l'océan se croisent des centaines de
flûtes qui transportent le vin, les prunes, le coton... et qui une fois rentrées
au port, en cas de conflit, sont armées de canons de marine rapidement, il suffit
de les embarquer, les emplacements sont prévus.
L'expression "armée en flûte" veut dire que le vaisseau est dépourvu
des batteries principales de canons (les plus gros calibres sur les ponts inférieurs)
pour faire place à de la troupe, c'était le cas du "Rhône" qui transférait
des militaires de Lorient à Brest.
Au 18ème siècle, les flûtes peuvent être d'anciens navires proche de la réforme
dont la mission est le transport de troupe et non les batailles navales, ce
peut être aussi celle d'hôpital flottant. Des flûtes étaient construites de
manière spécifique pour le transport de mâts par exemple. Ce transport nécessitait
des flûtes très nettement allongées.