Etang de l'Aber - Polder - Crozon

A l'horizon le Cap de la Chèvre. A gauche la pointe rocheuse de Raguenez, à droite la pointe du cordon dunaire. Entre les deux, des digues en projet entre la mer et le ruisseau de l'Aber en premier plan. A chaque marée haute, la mer inonde le polder pour la plus grande satisfaction de la nature. La zone était favorable au mouillage des pêcheurs et au ramassage des goémons pour l'agriculture.

L'étang de l'Aber côté terre.

La zone marine, en fond, derrière la route, la zone saumâtre en premier plan. Sur l'île de l'Aber, à l'horizon, (visite possible à marée basse) un fort défensif du 19ème siècle - corps de garde type 1846.

No man's land déprimant ? Non, faune et flore abondantes protégées mais fragiles. La zone a tendance à s'ensabler.

Un sanctuaire maritime de vie. Les dunes de l'horizon font barrage à la mer qui s'invite à chaque marée en remontant le cours d'eau douce pour occuper le polder partiellement. Des espèces végétales par dizaines... Les arbres ni survivent pas à cause du sel.

Lors des grandes marées, la mer envahit le polder au delà du cordon dunaire qui à terme disparaîtra. Les pentes agricoles ont toujours été privées mais au-delà, les convoitises ont provoqué des remous et des spéculations... Jusqu'à envisager une marina et des immeubles.

La route digue 1850, le four à chaux 1839 adossé à la motte féodale de Rozan 11ème et 12ème siècle. Entre 1850 et 1965, il fallait circuler devant le four puis derrière la motte pour rejoindre la route.


Observez, il y a un Chevalier qui pêche et un Courlis qui vous ignore.

L'étang fut un temps une terre cultivée sur laquelle des arbres et des buissons croissaient jusqu'à ce que la mer soit libérée des digues et revienne comme aux origines. Les arbres morts par le sel servent de perchoir aux oiseaux au-dessus de l'eau saumâtre !

La motte féodale de Rozan. Four à chaux sur le flanc droit.


La route digue. Polder en fond, étang en premier plan.


L'ancienne vicinale 8 bordant le four.

L'étang à marée haute.
Quelques dates :
Par le passé, l'étang de l'Aber et sa proximité sont du domaine maritime
à part quelques parcelles liées au hameau de Trébéron et à la commune
de Crozon, en principe ! Il y aura quelques tentatives d'appropriations
privées dont le comte de Crozon (René de la Porte, comte de Crozon, 1681)
et l'abbaye de Landévennec qui transférera son acquisition à l'Hôpital
Royal des Quinze-Vingts à Paris en 1835 par le biais d'Henry Alexis Larraton,
baron de la Gonde, pour une superficie de 84 hectares. Possession rendue
caduque par l'administration classant le bien dans le domaine maritime.
1834, Mme veuve de Merven fait établir des plans par l'architecte Mr Petit,
pour la réalisation d'une digue sur le littoral partant d'un cordon de
dune et arrivant sur l'autre rive du ruisseau de l'Aber. L'intention est
de transformer l'estuaire en terres agricoles plus lucratives. Refus de
l'administration et des usagers de l'estuaire comme les pêcheurs qui y
laissent leurs barques à l'abri, comme les agriculteurs qui viennent chercher
des amendements. Nouvelle tentative de digue par l'intervention de l'architecte
Adolphe Huyot dont la seule différence de plan est une légère variante
d'orientation de la digue que celle de son prédécesseur. Ce n'est qu'en
1836, que les avis divergents entre les pro-digues et les anti-digues
cesseront car la loi est claire, toute terre recouverte par la mer provisoirement
ne peut être aliénée par des intérêts privés. La mer modifiant en permanence
le dessin des parcelles, il est difficile d'en attribuer les droits à
des possédants.
1841, nouvelle démarche en faveur d'une digue par le propriétaire Louis
Victor Bourassin qui positionne un projet de digue de 250m de long qui
va aussi essuyer un refus. Ce propriétaire du four à chaux de Rozan, pense
à ses affaires et a un projet de moulin à eau sur la sortie des eaux douces.
1843, projet de route digue plus en retrait du service des Ponts et Chaussées
qui scinde l'estuaire en deux entre étang et zone maritime, une sorte
de compromis qui va convenir tant bien que mal aux intéressés. L'administration,
cette fois, y voit le signe d'une modernité de circulation. L'armée qui
a un droit de regard sur la défense des côtes n'y voit pas d'objection.
La loi impose l'achat des terres par des finances privées par enchères.
1849, l'entrepreneur de travaux publics de Brest, Almer Polinière, achète
la concession de 27 hectares au prix de 2175 frs au cours d'une adjudication
dont la mise à prix est de 1350 frs. Il revend en parts à 5 investisseurs
extérieurs à la presqu'île de Crozon dont Mr Bourassin, Mr Kerros et Mr
Duchâteau. Ce dernier est entrepreneur à Quimper et pourrait avoir contribué
au chantier.
1850, construction de la route digue. Le projet du moulin à eau est écarté.
La sortie d'eau douce de l'étang se fait par trois buses à clapet anti
retour. Mise en vente immédiate (13500 frs) du chantier achevé. L'un des
investisseurs, Barthélémy Kerros, remporte l'enchère à 14 500 frs.
1856, revente de la route digue, des terres et fermages voisins au notaire
de Crozon Louis Jules Alavoine pour 8500 frs.
1860, autorisation d'élévation d'un poste de douanes sur des terres (dune)
du cordon littoral. Le voisinage est privé avec parfois bien des peines
à prouver le statut de propriété privée.
1926, la zone dunaire est devenue un port d'échouage dont l'accès est
amélioré par déroctage de la partie orientale de l'estuaire de l'Aber.
1932, le service des douanes renonce à la possession à l'état d'abandon.
Celle-ci retourne dans le domaine privé après des enchères (mise à prix
1700 frs) clôturées à 3175 frs.
1942, l'armée d'occupation allemande envisage de fermer complètement l'estuaire
au niveau du cordon dunaire pour transformer la zone d'échange eau douce,
eau de mer, en zone inondée par l'alimentation du ruisseau exclusivement.
Le but recherché est de disposer d'une zone humide défensive permanente
contre d'éventuels parachutages. La réalisation n'a jamais existé bien
qu'il y ait eu des travaux.
1952, l'ingénieur Robert Richet fait connaître un projet de digue complet
asséchant la partie sablonneuse devant la route-digue.
1954, projet accepté par les différentes administrations dont certaines
imposent une digue insubmersible, des brises lames (40 m chacun), une
cale de remisage des barques. Plus de 40 hectares deviennent propriété
privée pour un prix de 300 000frs. L'ingénieur y verrait bien une belle
villa sur terrain arboré, au diable la vie locale.
1961, l'estuaire de l'Aber est classé site naturel !!! La pointe
de Raguenez et l'île
de l'Aber sont aussi concernées.
1963, projet d'élevage de moules évoqué. La mytiliculture ne soulève pas
l'enthousiasme.
Dans les années qui suivent des projets de marina sont explorés mais une
opposition écologiste monte en puissance et rien ne se passe.
1966, pose d'une clôture en poteau en béton dont il reste des vestiges.
1980, le conservatoire du littoral achète "l'estuaire".
1981, la digue Richet est déconstruite.
1987, le conservatoire du littoral augmente ses surfaces pour un total
de 87 hectares.
La zone humide de l'Aber se divise en deux parties distinctes. La séparation
est matérialisée par une route qui la traverse.
Côté mer, un milieu sablonneux de dunes et de prés-salés sur lequel court
une rivière à marée basse. A marée haute, la rivière sinueuse se dilue
dans l'eau salée. Cet ensemble est un lieu propice à la nidification des
oiseaux marins au printemps. L'accès y est interdit à cette saison...
du moins "officiellement".
Côté terre, un étang d'eau saumâtre avec ses incontournables vasières
et roselières dans lesquelles une faune abondante vit discrètement. Des
bruissements et des cris aux heures calmes du jour vous informent de la
présence de cette multitude. L'étang est aussi une aire de repos pour
les oiseaux migrateurs, et là, si la chance vous sourit et que vous avez
la délicatesse de quitter votre voiture, vous pouvez surprendre des espèces
d'oiseaux aquatiques considérés comme peu fréquents, voire rares... Les
oiseaux communs se trouvent en bordure de la route, habitués au tapage...
Les plus secrets préfèrent le fond de la zone humide de l'Aber et vous
demandent de vous munir de jumelles pour les observer sans les déranger,
question de respect !
Vous y verrez la motte
féodale de Rozan, aujourd'hui un simple monticule de terre qui semble
soutenir un four à chaux désaffecté. Le sommet de cette motte est un point
général d'observation.
Les différents aménagements du polder ont fait disparaître une flore qui
ne s'est jamais réinstallée depuis la réaffectation de la zone à l'état
presque naturel. Les lieux aujourd'hui voient passer chaque jour des visiteurs
qui ont toutes les peines à descendre de voiture et qui voient trois brins
d'herbe et une centaine de mouettes... Ce qui fait doucement rire, les
aigrettes, les hérons, les spatules blanches, les canards divers et variés,
les chevaliers, les courlis, les... Les euphorbes, les chardons,
les puccinellies, les chiendents... L'étang est une frayère grouillante,
les alevins y découvrent la vie chez les humains.
Le mot breton aber signifie estuaire tout simplement...



Vestiges de clôture.


Corps-morts de la zone de mouillage des barques de pêche.

Pointe du cordon dunaire, lieu de projets de digue.
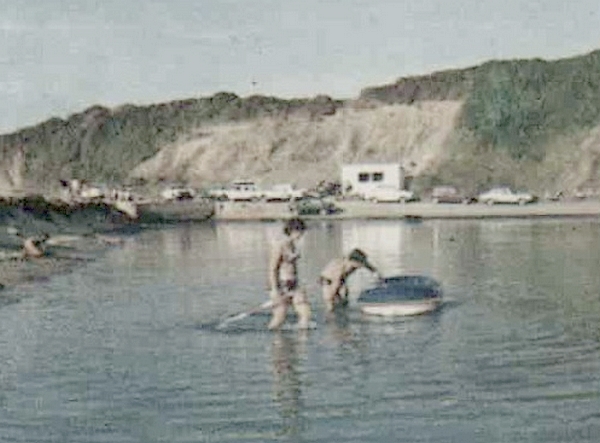


Digue Richet.

L'étang de l'Aber a toujours été une frayère indispensable.
°°°
Bâtiments publics Cale de St Nicolas Calvaires de Crozon Cap de la Chèvre Les carrières de Poulpatré Chapelles Cimetière de Crozon Colonies Ecoles & collège Eglise Saint Pierre et presbytère Les cloches de l'église L'étang de l'Aber Fontaines Four à Chaux de Rozan Bars hôtels restaurants Ile Perdue Pointe et éperon barré de Lostmarc'h Maisons de nobles Manoirs Menez Gorre Menhirs & dolmens Moulins à vent Personnalités "Petite ville de demain" Plage de Lostmarc'h Plage de la Palue / Palud Plage du Portzic Plage de Postolonnec Pointe du Guern / Tréboul Pont de Kervéneuré Ramassage industriel des galets Rostellec Histoires de rues Saint Norgard St Fiacre Tal-ar-Groas Ile Vierge L'urbanisme de la démolition Boulodrome L'île de l'Aber Bureau d'octroi°°°
Défense militaire GéologiePages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé
