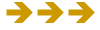La première cale du Fret dite de haute-mer


Les rochers et les perches du musoir appartiennent à la seconde cale.
Avant 1842, C'est le temps des rampes de débarquement ou
d'embarquement qui permettent tant bien que mal de faire atterrir les
passagers et les marchandises. Le conseil municipal de Crozon s'inquiète
de l'augmentation de fréquentation et vote en 1842 pour la construction
d'une cale. C'est assez rapidement que le plan de l'ingénieur Tourbiez
est mis en chantier.
A la fin de l'été 1844, cette cale achevée, mise en chantier par Alexandre
Péres de Camaret, facilite les déchargements des bateaux. Il semblerait
malheureusement que les choix techniques, autant l'orientation de la cale
que son étendue n'aient pas fait l'objet d'une grande anticipation puisque
cette disposition sera impraticable avec l'allongement progressif des
navires qui y accostent. Les forts coefficients de marée mettent la cale
à sec. La seconde cale palliera à tous ces inconvénients à partir de 1863.
Quoiqu'il en soit, l'édifice original est tout de même amélioré en 1962
sans pour autant tout corriger.
La cale - embarcadère de la Roche-Noire du Fret
Juste à la fin de la mise en chantier des quais du port,
on en profite pour aménager un chemin dans les rochers à la pointe du
Fret en 1863 pour compenser les insuffisances de la première cale du Fret.
La commune de Crozon dont dépend le port du Fret, espère ainsi accueillir
les vapeurs de voyageurs... Des touristes Brestois pour la plupart.
L'aménagement spartiate n'est pas du goût de la Compagnie Générale des
Paquebots à Vapeur Fluviaux et Maritimes qui est la société exploitante
des traversées de la rade de Brest pour le Fret. Les travaux reprennent
pour enfin obtenir un débarcadère digne de ce nom. En 1865, désormais
praticable, bien élevé, l'embarcadère de la Roche-Noire attire d'autres
compagnies maritimes telles que la Compagnie Aristide Vincent (ancien
maire de Landévennec) avec ses trois vapeurs le « Ville de Brest », le
« Ville de Landerneau » et le « Hubert Delisle » et la Compagnie Penhors
avec ses deux vapeurs l' « Utile 2 » et « Le Scorff » qui assurent des
liaisons fréquentes.
Un trafic de personnes et de marchandises en constante évolution jusqu'à
la première guerre mondiale. 5700 tonnes de marchandises débarquées et
120000 passagers en transit en 1911. La guerre, la création de la ligne
de chemin de fer, le pont de Térénez (1925) concourent à la fin d'un cycle
économique remarquable. Toutes les marchandises, ou presque, utiles aux
presqu'îliens viendront par le fer, puis la route...
Le dernier espoir vient de la pêche, la flottille des coquilliers qui
va écumer la rade a encore besoin d'un accostage de qualité. A cet effet
l'embarcadère est reconstruit de 1927 à 1932 dans un climat houleux car
les aménagements portuaires de la pêche peuvent être sensiblement distincts
des aménagements nécessaires au tourisme, les esprits s'échauffent.
Aujourd'hui la cale dite aussi de basse-mer (utile à marée basse) accueille
les passagers du transrade comme au bon vieux temps.
L'appellation les Roches-Noires existe aussi dans les anciens ouvrages. Quoi qu'il en soit les rochers sombres de schiste du port semblent être à l'origine de ce toponyme.


Le Fret vu de la cale des Roches-Noires.
Le port du Fret à découvrir
Liaison maritime le Fret - Brest
Villas de villégiature et maisons de notables
Monastère / couvent de Kerveden
Patrimoine militaire