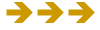Pêcheries des moines de l'abbaye de Landévennec

La vasière du Pâl de Landévennec est bordée par une continuité de perches (vestiges) dont l'origine est méconnue mais dont la disposition ressemble aux installations des pêcheries de l'abbaye de Landévennec du moyen-âge jusqu'au 18ème siècle.

Vestiges de perches sur la vasière du Pâl.

En premier plan le sillon du Pâl, ensuite sa vasière, puis les rangs de perches ruinées, en arrière l'Aulne / rade de Brest.



Les ruines de l'ancienne abbaye de Landévennec et son mur clos donnant sur la zone de pêche.


Le portail de l'abbaye qui donne sur le Pâl et les pêcheries...



La berge de l'abbaye est murée pour limiter les atteintes des marées.

Forts courants contraires entre la rivière et la mer.


Zone probable des pêcheries. A gauche, la rade de Brest et son eau de mer. En fond, à droite, la rivière du Faou en eau douce et enfin à droite, en premier plan, l'eau douce de la rivière Aulne, hautement fréquentée, fut un temps, par les saumons.
A la différence d'un vivier qui regroupe des pêches dans
un petit milieu clos en attendant la vente des poissons et des crustacés,
une pêcherie est un dispositif de capture installé sur le littoral, dans
un estuaire, dans une rivière ou un fleuve. « Barrage » fixe de pêche
qui remonte à l'antiquité. Le procédé consiste à planter des pieux jusqu'à
3,9 m de long (12 pieds) dans l'eau d'une zone de pêche de manière régulière
avec peu d'espace entre chacun d'eux. Dans la partie immergée la plus
profonde, il est nécessaire de croiser horizontalement des branchages
rectilignes comme lors d'un travail de vannerie. Sur la partie haute de
la « palissade » un filet de pêche en continu est tendu. Dans le cas de
l'abbaye de Landévennec, on ignore à partir de quelle époque les moines
installent des pêcheries sur l'estuaire de la rivière Aulne qui se jette
dans la Rade de Brest. L'abbaye ayant été à plusieurs reprises pillée,
des textes anciens nomment cependant Jean Briant / Brient, abbé de la
Commende de Landévennec en tant que restaurateur et moderniste qui décide
de remettre en ordre les pêcheries vers 1610.
Ensuite l'activité est décrite partiellement dans des concordats datant
essentiellement du 17ème siècle sachant que si les moines œuvrent avec
plus ou moins d'efficacité à l'entretien de deux pêcheries, ceux-ci sont
en litige constant avec l'abbé commendataire, le gestionnaire financier,
de l'abbaye à qui revient un tiers de la valeur des poissons capturés,
ceci étant, ce dernier doit fournir la quantité de bois utile à l'entretien
des pêcheries.
Une pêcherie qui enferme des saumons, des sardines, des thons, consomme
énormément de bois car les marées arrachent des pieux /perches et la navigation
fluviale vers Châteaulin en fait de même. L'abbé quant à lui est mandaté
pour faire des bénéfices et ces bénéfices viennent de la coupe de bois
de chauffage de jeunes arbres alors que la fabrication des pieux réclament
des bois d'un quart de siècle d'existence qui se vendent moins chers.
Trop gros pour la chauffe, trop petits pour la menuiserie. En l'absence
de bois adapté pour cause de coupes intensives ordonnées par l'abbé sur
les parcelles proches de l'abbaye, les moines parviennent difficilement
à se fournir par des coupes, sur des terres de l'abbaye, ce qui rend leurs
pêches bien ingrates. L'abbé, quel qu'il soit, accuse les moines d'être
des incapables et les moines assurent que l'abbé vend des bois à tort
et à travers pour des rentrées d'argent immédiates. La collecte des baliveaux
de treillage n'est guère plus aisée car les baliveaux sont les rejets
après une coupe pour devenir futaie ainsi, les moines ulcérés par les
procédures et les accords sans suite avec la commende, semblent abandonner
les pêcheries dès le début du 18ème siècle. Période d'abandon général
de la pratique...
Parmi les nombreux rapports de situation souvent destinés aux délibérés
de la Table de Marbre, haute instance juridique des Eaux et Forêts en
lien avec l'autorité royale, il est mentionné jusqu'à quatre pêcheries
au pied de l'ancienne abbaye qui devaient traverser le Pâl d'aujourd'hui
et plus encore. L'une aurait été d'une longueur de 1700 mètres (856 toises).
Lors d'une estimation de travaux de 1676, on parle alors de 3980 pieux
à changer. Preuve à charge des coûts d'entretien.
Les pêcheries bretonnes déplaisent aux rois de France.
• L'ordonnance royale de 1544 – François 1er, interdit
les pêcheries nouvelles qui se multiplient sur la côte bretonne. Les seigneurs
bretons feignent d'ignorer le rattachement de la Bretagne (1532) au royaume
de France. Le roi constate une privatisation du domaine maritime dont
les bénéfices lui échappent. L'ordonnance ne sera jamais respectée.
• L'édit du 15 mars 1584 (articles 84-85), conseillé par l'amiral
Anne de Joyeuse (Mignon) au roi Henri III régulant les pêcheries, tombe
aussi dans les oubliettes.
• L'édit du 4 février 1593 – Henri IV, fait interdiction
des pêcheries. Sans suite.
• 1629 – Louis XIII,: le garde des Sceaux, Michel de
Marillac, sous le Code Michau, republie les articles de l'édit de 1584
sans plus de succès.
• Ordonnance du 14 mars 1642 : Richelieu, Grand Maître de la
Navigation s'y risque et échoue.
• En 1669 – Louis XIV, une ordonnance royale interdit
les pêcheries sur les rivières et les fleuves à cause des incidents de
navigation. Pas de changement en vue même si les incidents de navigation
sont bien réels.
• Une réglementation nationale est publiée en 1681. Une version
bretonne (1684) pour tenir compte des droits des seigneurs bretons dicte
que les pêcheries d'avant 1544 peuvent être maintenue mais celles au delà
la date fatidique sont interdites et doivent être démolies. Des commissions
vont s'attacher, sur le terrain, à vérifier les prélèvements seigneuriaux,
les taxes, les droits pour exercer une pression directe. La projection
s'avère délicate, voire « politique ».
• Le 1er juillet 1726 – Louis XV, l'inspecteur général
des pêches pour les provinces de Flandres, Picardie, Normandie et Bretagne,
François Le Masson du Parc, adresse aux propriétaires des actions administratives
menaçantes pour qu'enfin les pêcheries disparaissent. L'envoyé du roi
joue avec le phénomène écologique de la préservation des alevins. Problème
de la ressource avéré mais ce n'est pas pour autant que l'exploitation
soit régulée.
• Le 17 septembre 1726 : publication de l'arrêt du Conseil
d’État qui ordonne le respect de l'ordonnance de 1544 et le corpus de
1681. Sans effet.
• 1733 : ciblage amirauté par amirauté des pêcheries à détruire
faute de preuve d'antériorité à 1544. Cependant, la royauté propose des
exceptions politiciennes qui vont devenir légion. Quant à poursuivre les
propriétaires fichés, les pêcheries sont sous-traitées à des fermiers
qui les sous-traitent à des fermiers pêcheurs qui ne savent ni lire, ni
écrire.
• Une commission extraordinaire vérifie méthodiquement les
droits littoraux à partir du 21 avril 1739. Commission alternative puisqu'elle
disparaît et reparaît durant des années, jusqu'en 1755.
Ce sont les plaintes de plus en plus récurrentes des marins navigateurs
qui vont venir à bout de cette résistance à l'autorité royale. Les caboteurs
s'empalent sur les pieux des pêcheries et les dégâts sont coûteux. En
plus de cela, les pieux facilitent l'ensablement des passes. Ajouté au
fait que la rentabilité des pêcheries est de plus en plus discutable,
les nobles et le clergé abandonnent la pratique d'eux-même sans l'aide
des rois.
En ce qui concerne, les pêcheries de Landévennec, il ne semble plus y
avoir trace de cette pêche mi 18ème siècle. Probablement, une « faillite
» et non une soumission.
Il semblerait qu'il y ait eu une ou plusieurs tentatives de viviers menées
par les moines...
Landévennec à découvrir
Aller à l'essentiel
Par curiosité
Histoire
Henriette Antoinette Rideau Vincent
Magasins - anciens petits commerces
Inscriptions latines sur la pierre tombale du recteur
Patrimoine militaire