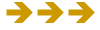Le Pin maritime, l'arbre invasif de la lande

Ancienne lande d'Argol disparue au profit d'une pinède artificielle.

Cônes femelles – pommes de pin à graines (gauche) & cônes mâles à pollen (droite). A la saison des pollens la presqu'île de Crozon est recouverte d'une poudre jaune soufre.


Un châtaignier tente de trouver la lumière sous deux pins maritimes.

Jeune Pin maritime colonisant une zone herbeuse. Si ce pin parvient à maturité, il n'y aura plus d'herbe et le biotope en sera modifié.


Pousse par section. D'abord la branche avec des aiguilles courtes. Puis une fois la pousse de la section terminée pour l'année, les aiguilles s'agrandissent de 10 à 17 cm selon la santé de l'arbre.

Croissance rapide du Pin maritime, tout d'abord de forme conique durant sa jeunesse puis dégarni du tronc avec un toupet branchu ensuite. Hauteur maximale après 30 ans : 30 mètres. Durée de vie dans de bonnes conditions sanitaires : 50 ans.

Le moindre espoir d'une agriculture prospère en presqu'île
de Crozon s'évanouit à la fin du 19ème siècle surtout pour les terres
littorales impropres à la culture céréalière ou maraîchère, alors une
nouvelle idée germa pour tenter d'obtenir un revenu des terres sablonneuses
ou des landes rocailleuses, la culture du Pin maritime par des semis économiques.
La rentabilité était affichée : en 20 ans (dans la réalité mieux valait
attendre 30 ans) les parcelles ensemencées étaient à maturité pour une
coupe de pins adultes de laquelle il fallait compter un bénéfice de 6000
fr l'hectare (estimation 1893). La destination des grumes était même décrite
dans des publications spécialisées que la presse reprenait : le débouché
était la fabrication d'étais pour les mines anglaises. Les grainetiers
y voyaient un nouveau débouché. Le magasin très estimé de l'époque se
situait à Brest : M. A. Huon, au 13 rue de Siam. 1,5 fr le kilo de graines
de Pin maritime.
Pour mémoire : il a été trouvé des empreintes fossiles de graines de pins
en presqu'île de Crozon prouvant qu'une forêt de résineux naturelle exista
dans un lointain passé à une période où la presqu'île était émergée durablement
avant de replonger sous le niveau de la mer !
Cette fois l'apparition des résineux était donc artificielle. La première
génération de l'ère moderne des pins maritimes fut semée vers 1880. La
lande vit croître des arbres méconnus que l'on trouva plutôt esthétiques.
Esthétiques et appropriés puisque même l'armée, en Roscanvel tout particulièrement,
utilisait ce nouveau brise-vue pour masquer des bâtis que trop visibles
de la mer pouvant être ciblés par de l'artillerie de marine ennemie.
L'argument de la protection fut repris par l'agriculture. Il était conseillé
de faire des semis de pin sur les hauts des falaises pour briser, cette
fois, les effets néfastes des vents tempétueux sur les cultures ou sur
les pentys
– maisons traditionnelles. On pensait alors que les racines des
pins consolideraient la falaise elle-même et limiteraient les éboulements.
Là encore la réalité était tout autre. Les racines fracturent la roche
et augmentent les infiltrations des eaux
de ruissellement qui favorisent l'érosion.
Semis en ligne directement dans la lande (des rangs espacés d'1,5m et
des graines en ligne espacées d'1m), cette dernière assurant la protection
des arbrisseaux. Il fallait prévoir une clôture pour éviter que le rare
bétail allât paître dans les landes ensemencées. Pendant une dizaine d'années,
l'agriculteur pouvait faucher sa lande avant de la passer au hachoir.
Dans les années 1930, les pins maritimes devinrent un atout touristique
avec en premier plan le bois
du Kador / Gador dont on en fit des représentations illustrées puis
photographiques largement commentées par des écrits dithyrambiques : «
Le bois du Gador,
Le charme spécial de Morgat, ce sont les retraites qu'il assure aux amateurs
de solitude : soit les grottes, soit les pinèdes qui coiffent les hauteurs
du Gador. Ici, dans la senteur balsamique des pins, on peut couler des
heures exquises. Les arbres sont si pressés qu'on n'aperçoit plus le ciel.
Lumière de parasol vert. Sol de mousse, de fougères, de brindilles sèches.
Ailes froufroutantes, cliquetis d'insectes. Le moindre bruit acquiert
de l'importance, devient irrespectueux, comme dans une cathédrale. Seul
le silence convient ici.
Pierre Avez. Dépêche de Brest. 10/08/1929. »
A la même période, le semis fut quelque peu mis de côté par les propriétaires
qui en avaient les moyens. Des potets – petits pots – comportant
un jeune plant étaient livrés par milliers après un voyage en train provenant
de pépinières. La plantation offrait un meilleur rendement de 6000 plants
à l'hectare au lieu de 4000 en cas de semis et ceci dans le meilleur des
cas. La Société forestière scolaire et post-scolaire de Scrignac (Sud-Est
de Morlaix) « boisait » le Finistère avec ses plantules. Les particuliers
membres de l'organisme passaient commande : Mr Bouvron d'Argol reçut en
port dû 15000 potets à Argol en 1931. 15000 pins de 20 cm de hauteur qu'il
fallut mettre en terre à l'automne suivant.
Après l'engouement, quelques inquiétudes. Le pin flambait comme une allumette.
On commença à signaler les premiers incendies catastrophiques dont celui
du bois du Kador en août 1937... Un mégot avait-on dit.
Il était déjà trop tard pour circonscrire la répartition galopante des
pins qui débordait des parcelles initiales. Semis naturels à tout vent,
chaque arbre disséminait des centaines de graines portées à plusieurs
dizaines de mètres, la plupart atteignant un sol humide propice à la germination...
Des vols de coupe prirent forme dès que la maturité des boqueteaux arriva.
Un délit inconnu jusqu'alors. Un vol de grumes résineuses en pleine guerre
(1943) à Morgat secoua les esprits. Le propriétaire porta plainte auprès
du procureur de la République au Parquet de Châteaulin.
Les autorités allemandes ordonnèrent de plus en plus de coupes de pins
maritimes pour planter des pieux
dans les zones probables de parachutages alliés en 1944. Tout homme valide
civil fut requis à la tâche. Dans les faits : piètre résultat. Les quantités
de pieux exigées pour couvrir des hectares de terres planes dépassaient
le nombre d'arbres des zones boisées. Les soldats Allemands sur place
n'y croyaient pas davantage et laissèrent l'immense chantier se dégrader
sans l'achever vraiment.
Après guerre une nouvelle campagne de boisage fut entreprise. Les anciens
massifs de chêne furent remplacés par des résineux (pas uniquement des
pins maritimes). Les moindres parcelles exploitables furent semées ou
plantées...
Aujourd'hui bien qu'il y eut des programmes de désenrésinement parfois
soutenus par la commission européenne, le Pin maritime poursuit sa progression
et contribue à la réduction de la lande qui souffre aussi de l'envahissement
des fougères, des prunelliers,
des ajoncs... Par
exemple : coupe sanitaire au Kador après les tempêtes de 2013/2014 en
avril 2015. Les tourbières vivent une fin probable avec l'appui des sécheresses...
Actuellement, le Pin maritime est devenu une calamité par l'acidité des
aiguilles qui tombent sur un sol où plus rien ne pousse en dehors des
fougères et de quelques ronces hardies. L'exploitation des arbres n'est
pas rentable car largement contrariée par les exploitations du nordique
Pin Sylvestre dont la fibre est moins noueuse. Autrement dit le Pin maritime
est un encombrant dont on ne sait que faire.
Le Pin maritime ou Pin des Landes, Pin de Bordeaux,
Pin de Corte, Pin mésogéen – Pinus pinaster – est d'origine
portugaise et espagnole puis des Landes (France). Dès le 17ème siècle
des semis sont organisés pour une exploitation des pins pour la fabrication
de goudron – brai – utile à l'étanchéité des embarcations
de marine.
Les aiguilles de pin étaient ramassées pour faire un feu doux sous le/la
bilig/billig : plaque en fonte circulaire plate pour cuire les crêpes.
La flore de la presqu'île de Crozon
Identification des fleurs sauvages
Changement de couleur des fleurs
Forêt domaniale de Landévennec
Chasmophyte - plante de fissure
Herbiers de zostères - prairie sous-marine
Les plantes invasives et le climat