Les chemins creux bretons

Le chemin creux type qui maille encore la pesqu'île de Crozon. Des kilomètres à se perdre en bord de mer, en rase campagne, une impression de vivre dans un passé révolu. Les presqu'îliens parcouraient des distances impensables aujourd'hui, en sabots de bois – avec des chaussettes pour les bretons ayant une petite aisance. La pauvreté paillait ses sabots.

Le chemin creux sous une voûte végétale, sa douve étant un ru et ses talus étant des murs en pierres sèches... Un grand classique de la presqu'île.
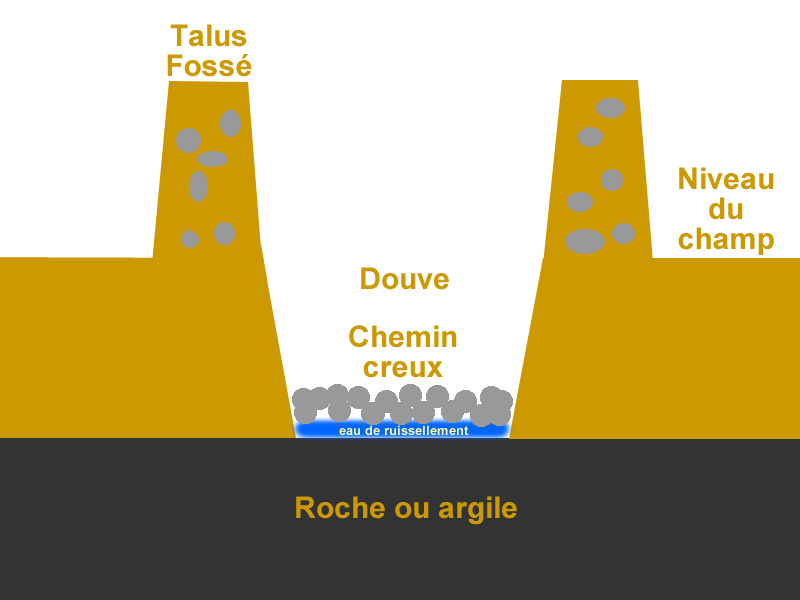
Le chemin
creux breton détenait ses petits particularismes.
Tout d'abord la définition du chemin creux correspond à un chemin bordé
de talus dont le niveau général est plus bas que les terres avoisinantes.
Ce creux n'est pas naturel mais correspond au creusement des paysans pour
prélever la terre boueuse hivernale et atteindre à minima l'argile et
si possible la roche souterraine. Pour les chemins creux à la circulation
« intense » des tombereaux – brancards – charrettes – le carrossage
était une obligation pour éviter l'embourbement. Le carrossage consistait
à empierrer le fond du chemin nommé douve. La largeur habituelle en fond
de douve était de 70 à 85 cm en presqu'île de Crozon. Le passage du rare
bétail pouvait détériorer la relative stabilité du sol. Le chemin devait
être régulièrement curé.
Jusqu'en 1789, bien que les paysans ne furent pas propriétaires de ces
chemins, les seigneurs locaux imposaient des corvées dites seigneuriales
d'entretien au delà des heures des tâches au champ ou plusieurs jours
par an selon les exigences du noble qui usait de ses terres à volonté
y compris celle de détériorer ses chemins par ses chasses. Travail non
rémunéré et considéré comme un impôt non encaissé. Les paysans « profitaient
» des terres et donc en contrepartie, il leur était demandé d'en entretenir
les accès. L'injustice était que le produit du travail des terres revenait
au seigneur pour l'essentiel et non pas aux serfs « corvéables à merci
» . Etre « imposé » sur un revenu non perçu était vécu comme l'une des
plus grandes injustices de l'ancien régime. Ce fut d'ailleurs, à la Révolution,
la première demande paysanne dans le cahier des doléances de la presqu'île
de Crozon que de supprimer la corvée des chemins, ce qui fut accordé par
l'administration révolutionnaire. Un des acquis du changement de régime
qui marqua vraiment les esprits... Pour le reste, la révolution fut moindrement
comprise pour ce que l'on en sut en presqu'île, soit pas grand chose.
La noblesse francophone lettrée n'allait pas enseigner les rudiments des
pertes de privilèges à une population analphabète bretonnante soumise
à l'église et à la noblesse.
La particularité bretonne du chemin creux était de l'ordre du vocabulaire.
Les talus étaient élevés par des matériaux de creusement du chemin et
des matériaux « dérangeants » des champs. Talus pour les français ; fossés
pour les bretons !
Un fossé français est un creux et non une saillie... Le fossé/talus en
droit breton d'antan n'appartenait pas au champ. Bien des conflits de
voisinage naquirent de par les actes notariés rédigés par des notaires
d'origine bretonne et les notaires français. Le talus français appartenant
au propriétaire du champ et le fossé breton étant attaché au chemin creux
: selon qui lisait l'acte comprenait la chose différemment. Les actes
étaient rédigés en français, une langue que les presqu'îliens ne parlaient
pas en dehors de quelques administratifs du bourg de Crozon formés à Rennes
ou plus loin encore et ignorant la tradition locale...
°°°
Tradition
La coiffe du pays Rouzig • La coiffe Penn-Maout
Pierres
Abreuvoirs & auges • Four à pain traditionnel breton • Ardoises gravées • Murs en pierres sèches • Lettres inversées • Appareillage en granit rose
Construction & équipement
Bac de lavage en béton • Pompe à bras • Puits • Pompage électrique • Borne incendie • Voies Decauville • Arrondir les angles • Fenêtre à traverse • Garde-corps de fenêtre en ferronnerie • Soubassement en faux-appareils • Clôture en béton armé sur mur bahut des années 1920-1930 • Devantures • Mosaïques et devantures • Aubette • Panneau indicateur • Panneau à l'envers • Panneaux électoraux • Palplanche • Gués • Carrières • Tessons de bouteille sur les murs • Radar pédagogique • Panonceau notaire • Chemin creux • Toilettes publiques • Bilinguisme routier • Ecluses routières • Maisons préfabriquées • Couleurs de façade • Crochet de façade • Maison traditionnelle : Penty • Gestion du patrimoine foncier communal • WC • Entretien du sentier côtier - GR34
Religieux
Niche votive • Echalier d'enclos paroissial • Tombe en ardoise • Tombe en fer forgé et fonte d'art • Croix celtique • Croix huguenote • Sablière sculptée • Tronc • Calice • Concession
Transports
Chemins des goémoniers • Maison bateau de Crozon : une caloge • Gares bigoudenes • Ponts ferroviaires • Voies Decauville • Garde-fou • Conteneurs SNCF • Hélicoptère Samu • Rando vélo • Sentier des douaniers - GR34
Marine
Cachoutage des voiles • Grand pavois • Embossage • Canon bollard • Mouillage forain • Balise de Basse Vieille • Espar • Balise Rocher du Mengant Mengam • Balise maritime de danger • Bouée métal
Nature
Brume et embruns - différence • Pourquoi pleut-il en Bretagne ? Tout le temps ? • Coup de vent et tempêtes • Ecume de mer • Mer • Soleil • Lune • Ruisseau du Kerloc'h • Ruisseau de l'Aber • Ganivelle • Bois de chauffage d'antan • Rade de Brest
Trouvailles
Vélo Anquetil • Moteur CLM - • Vieilles tiges • Publicités murales • Street-art • Container • Pot de chambre • Détecteur de métaux • Sirop Bailly • Vestiges à identifier • Matériels agricoles • Fiddler's Green
Pages récentes : Un point d'inondation naturelle • Bassins tampons • André Antoine, les artistes de Camaret par Georges G. Toudouze • Remonter de Camaret-sur-Mer comme à Paris • Poste de relèvement • Crochet de façade • Travaux du Relais des pêcheurs une saucée ! • Vélos électriques en libre-service : flop • Hôtel Gradlon en Telgruc • Urbanisation du littoral 1970 • PRECARITE • Cimetière de Telgruc • Bureau d'octroi de Crozon • Les unités de la Luftwaffe présentent en presqu'île de Crozon • Plage du Portzic • Régate voiliers modèles-réduits • Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé
