Eglises et Chapelles de Crozon en 1789
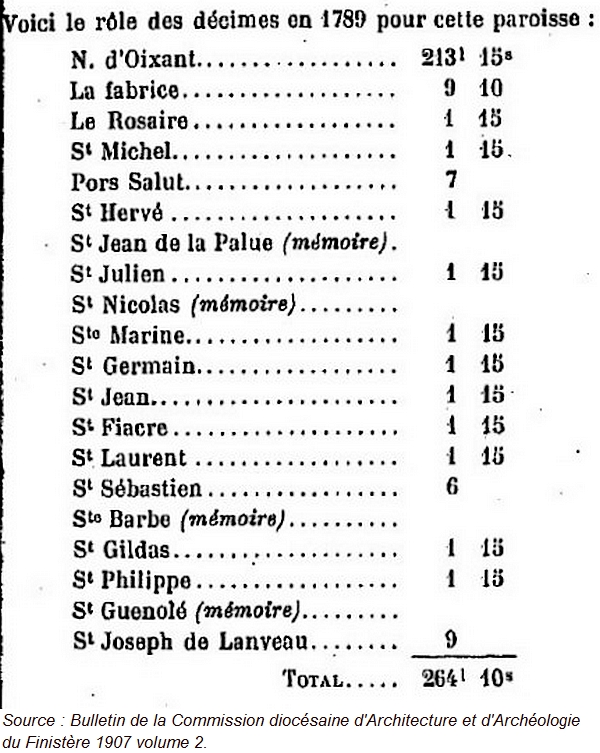
Les décimes sont une taxe au « dixième » sur les revenus
des biens du clergé perçue à chaque paroisse, versée au diocèse et reversée
au roi. Le relevé publié ci-dessus révèle les églises et chapelles ouvertes
(ou ruinées) en 1789 à la veille de la Révolution Française.
Joseph-Louis Heussaff d'Oixtant, recteur de Crozon 1774-1790 : 213 livres
15 sols. Responsable de la paroisse de Crozon et des curés qui y officiaient.
La fabrice : collectif de paroissiens dirigé par un fabricien qui assurait
la gestion des finances de la paroisse. Dépenses, recettes...
Le Rosaire : confrérie installée à Crozon. Une chapelle du Rosaire existait
aussi (seigneuriale) et une des Martyrs (seigneuriale). Toutes deux disparues.
Chapelle
de St Michel, hameau de Tromel.
Pors Salut – Porz
Salud.
Chapelle St Hervé – St
Hernot.
Chapelle Saint Jean de la Palue, hameau de Lesteven, disparue bien avant
1789.
Chapelle
St Julien, hameau de Lannilien. Actuellement sur la commune de Camaret-sur-Mer
mais à l'époque située sur la commune de Crozon.
Chapelle St Nicolas au Cap de la Chèvre, hameau de Rostudel, disparue
bien avant 1789.
Chapelle Ste Marine à Morgat ruinée, remplacée par une baraque en bois
puis par la chapelle
Notre Dame de Gwel Mor.
Chapelle St Germain, hameau de Quézédé.
Chapelle
St Jean Leidez.
Chapelle
St Fiacre.
Chapelle
St Laurent.
Chapelle St Sébastien, entre Le Gouerest et Trévarguen en Roscanvel
(ces hameaux étaient sur la commune de Crozon alors).
Chapelle Ste Barbe, hameau de Lambézen (alors en Crozon, actuellement
en Camaret), disparue bien avant 1789.
Chapelle
St Gildas.
Chapelle St Philippe – St
Philibert.
Chapelle St Guénolé, hameau de St Guénolé, disparue bien avant 1789.
Chapelle St Joseph de Lanveau (chapelle sise sur l'actuelle base de Lanvéoc-Poulmic
- détruite - commune de Crozon alors).
Hors liste / hors époque :
Chapelle Sainte-Madeleine attenante au presbytère. Ecole en 1806 et 1811.
Le diocèse céda le bâti à la commune en échange d'une réfection du presbytère.
Chapelle de Kersiguénou consignée sur la carte de Cassini.
Oratoire de l'île de Trébéron.
Couvent
de Kerveden au Fret – Covent Kerveden ar Fret.
La commune de Crozon a une superficie de 80.37 km² aujourd'hui,
à la Révolution et bien avant, il fallait ajouter le 1/4
Sud de Roscanvel, 1/4
Est de Camaret et la totalité de l'actuelle Lanvéoc...
Pour des questions administratives et de prérogatives, les limites de
la commune furent plusieurs fois redessinées en sa défaveur. Et si aujourd'hui,
on dénombre 155 hameaux et 4 quartiers / villages : Morgat, Tal ar Groas,
Le Fret / Saint-Fiacre, Saint-Hernot, jusqu'au 18ème inclus, le nombre
de hameaux étaient plus élevés encore. A défaut de chapelle tréviale,
on élevait un calvaire
à chaque recoin pour mailler la paroisse et rappeler aux paroissiens l'omniprésence
de l'Eglise.
Les budgets de construction provenaient des dons de la noblesse pour l'essentiel
qui en échange avait le droit d'être enterrée dans le chœur de l'édifice
au plus près de Dieu. Ce n'est qu'avec l'augmentation de la population
et donc des défunts que l'on sortit les morts dans le cimetière "collé"
aux murs de l'église. Certains pieds cadavériques passaient dans les fondations
tant on escomptait la protection du Seigneur tout puissant. L'église
de Roscanvel souffrit d'instabilité à cause de cette pratique.
L'entretien des chapelles et des églises fut une source de difficultés
permanentes d'un point de vue financier. Les Crozonnais étaient pauvres
de génération en génération. La noblesse* constatait que ses revenus agricoles
resteraient indéfiniment médiocres, les quêtes et sollicitations organisées
par les curés de la paroisse suffisaient à peine à les rétribuer. Les
quelques rénovations étaient le fruit, bien souvent, du travail des paroissiens
qui ajoutaient ce labeur à toutes les corvées obligatoires issues traditionnellement
du système féodal.
* La noblesse spoliait allègrement les terres de l'abbaye de Landévennec et parfois pour éviter le procès infamant, la noblesse investissait dans le patrimoine bâti de l'église. La faiblesse des revenus fonciers que tirèrent ces deux forces alliées par obligation de survivance, fit naître une génération bourgeoise commerçante qui ne s'appuya que sur l'argent pour régner. L'entretien des églises et des chapelles devint très secondaire sachant que la religiosité ambiante était en décrue permanente. Puis vint le temps de la laïcité comme premier prix de vertu.
°°°
Préhistoire
Galet aménagé / Chopper • Temples druidiques ?
L'empire romain
Camp romain du Kerloc'h • Monnaie de Postume • Voies romaines • Tuiles romaines
L'ancien régime
L'histoire du comté de Crozon • Les fourches patibulaires • Jeanne de Navarre quitte la Bretagne par le port du Fret • Maître des barques • La loi du milliard pour les émigrés • Attaques des diligences • Eglises et chapelles 1789 • Motte castrale • Mode de vie au moyen-âge • Terres vaines et vagues • Arabie pétrée • Le cahier de doléances de Crozon de 1789 • Premiers députés de la presqu'île de Crozon
Personnalités
Marguerite de Savoie • Vice-amiral Thévenard • Maréchal Philippe Pétain • Jean Moulin • Louis-Ferdinand Céline • La visite d'Erwin Rommel • Louis Prucser moine résistant • Gabrielle Colonna-Romano • Louis Jouvet • Monique Keraudren & Gérard Aymonin botanistes • Frère François le Bail géologue • Macron à Crozon carton rouge 2018 • Les architectes qui comptent • Papes Grégoire XI et Paul II • Roi Marc'h • Guillaume Balay • Camille Vallaud
Artistes
Marie-Jo Guével • Gérard Guéguéniat • Alphonse et Gabriel Chanteau • Pierre Chanteau • Maxime Maufra • Jim E Sévellec • Georges Violet • Marcel Sauvaige • Eugène Boudin
Les gens
Statut social des femmes par leurs pierres tombales • Les femmes dans les conseils municipaux • Conseils municipaux & bourre-pif • Les épidémies • Baisse de la population à cause du sable marin • Resencement : baisse du nombre d'habitants • Christianisation • Mariage • Mariages consanguins • Divorce • Curés de campagne • Les Filles du Saint Esprit • Prière prônale • Vendeur colporteur de presse VCP • Démocratie participative • RIP Référendum d'initiative partagée • Précarité et délinquance • Procès verbal • Almanach du forestier • Tour de France • Covid 19 • Aide sociale d'antan • Infanticide • Cadavres échoués • Annonces de rencontre • Les inventeurs • Identité - pêche ou agriculture • L'oie blanche • Douanier • Téléconsultation
Pêche
Locations au Fret pour les pêcheurs de coquilles • Une vie de sardinier • Crise sardinière le vrai le faux • Extermination des bélugas au canon • Le Mauritanien Rocamadour • L'histoire des Mauritaniens • Péri ou disparu en mer • La Janine monument historique • Dundee • Dragage du maërl et des goémons rouges • Mouillage des sardiniers • Ports de pêche
Epaves et échouages
D'autres épaves • L'échouage du Pérou • L'échouage du Duguesclin • Indemnisations de l'Erika
Vieilles coques
Inauguration du navire école Charles Daniélou • Horreur à bord du Breslaw • Voiliers anciens et vieilles coques • Voile pince de crabe • Grésillon • Chaloupe traversière • Bateau à vapeur l'Averse • La Fauvette • Les ancres qui chassent
Navires d'aujourd'hui
Vedette des douanes en sauvetage • Vedettes PM 509 PM 510 • Stellamaris • Câblier • Remorqueur océanique • Abeille Bourbon • BSAA Sapeur • Atalante Ifremer
Tempêtes
Tempête Amélie • Bombe météorologique Ciarán
Légendes coutumes traditions toponymes
La chasse aux Cormorans, l'occasion de marier la fille • Le Galant-Passeur • La légende des Korrigans • Traduction de toponymes • Lan • Ermitage • Garenne Goarem • Hagiotoponymes • Drapeau en berne • Toul / Toull / Trou
Aménagements
L'histoire des moulins • Les cloches sous la Révolution • Coq de Clocher • Livre terrier et cadastre napoléonien • Cadastre napoléonien extinction en 1974 • Manoir disparu • Leuré & Guenvenez • Petit commerce • Fruiterie • Plaque émaillée licence IV • Boîte jaune de la Poste • Câble sous-marin • Antennes-relais • Poteaux en béton • Poteaux en bois • Poteaux composites & fibres de verre • Déploiement de la fibre optique • Adressage • histoire du réseau électrique en presqu'île • Lignes de haute-tension • Poste de transformation de haute tension • Repère de nivellement général • Pistes cyclables • L'évolution de l'usage de la voiture • L'histoire des pompes à essence • Rallye Super - Casino - Leader Price - Aldi • Faire la buée • Chantiers Courté • PLUiH • Désert médical • Diorama • Carrières de pavés de l'Île Longue • Extraction du sable et des galets du rivage • Routes et chemins • Vitesse en ville limitée à 8km/h
Culture
Tournages de films de cinéma • Séries Tv et courts métrages • Orchestre de la WW2 • Flamme olympique
Pages récentes : Toul & Trou • Piste cyclable en milieu urbain : dangers déplacés • L'état des lieux de Cambry • L'île de l'Aber selon la Pylaie • L'île de l'Aber • Epave sur terrain privé • Consessions dans le rouge • Citerne souple tendance ? • plage du Veryac'h • Ponceau du Corréjou • Tannerie au cachou • Dentiste gratuit
